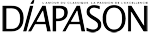Couplage inédit: les seules sonates d'une décennie 1810 peu productive sur ce terrain. Après s'être confronté à l'œuvre monstre par excellence, le pianiste s'empare d'une création à la "forme extravagante, à nulle autre pareille" (André Boucourechliev), avant qu'une partition on ne peut plus limpide ne lui donne l'occasion de souffler. Trois sonates, trois formats contrastés au possible.
Dans Le Style classique, Charles Rosen met le doigt sur un des dangers qui guettent l'interprète de la "Hammerklavier": transformer les mesures initiales en Allegro maestoso, alors qu’elles devraient surgir avec une vigueur ahurissante. La question du tempo reste centrale dans l'œuvre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Steven Osborne ne tombe pas dans cet écueil: on a rarement entendu un premier mouvement à la rage aussi athlétique, à l'urgence aussi effervescente. De ce point de vue, il n'a guère à rougir devant la récente et marquante version d'Igor Levit (Sony). Le out est ficelé en quarante minutes, comme Schnabel naguère. La fugue, abordée à fond de train, est formidablement enlevée et menée. Pris à bras-le-corps, l'ensemble rend justice à l'audace révolutionnaire de la partition. Petite réserve concernant le mouvement lent, ou notre héros semble quelque peu désemparé face à ces passages ou ne subisse quasi niente, seulement de vagues filaments de notes voletant sur une surface désolée. Réécoutons Backhaus en studio (Decca) ou en concert (ICA, avec une fugue invraisemblable): la tension permanente n'y laisse jamais l'auditeur perdre le fil du discours. De plus, chez Osborne, l'indication "con la piu grade espressione" , si rare chez Beethoven, disparait en cours de route. On lui sait néanmoins gré de ne pas trainer; ces dix-sept minutes le rapprochent de Brendel et Pollini, plus que des Guilels (vingt minutes), Solomon (vingt-deux) et Korstick (vingt-huit, cas extrême). Et il faut redire que dans les autres mouvements, ce pianiste également applaudi dans son intégrale Ravel chez le même éditeur, triomphe.
Les deux autres sonates ? Le déroutant Opus 101—il commence comme une bagatelle, prend l’allure d’une marche au rythme obsessionnel puis finit, après un Adagio étonnamment bref, par une fugue robuste—bénéficie de la poigne salutaire, de l’approche virile et directe d’Osborne. Une des plus belles confidences du compositeur, l’Opus 90 n’est pas toujours reconnu à sa juste valeur—Arthur Rubinstein regrettait l’uniformité du Rondo au regard de la sensibilité peine de force du premier volet, alors que c’est précisément ce chant immuable qui signe sa réssite singulière. Tendue et lyrique, chaleureuse et intimiste, la sonate se déploie sans contraintes sous les doigts du pianiste écossais.
Steven Osborne confirme pour son troisième enregistrement beethovénien ses affinités peu banales avec le compositeur allemand.